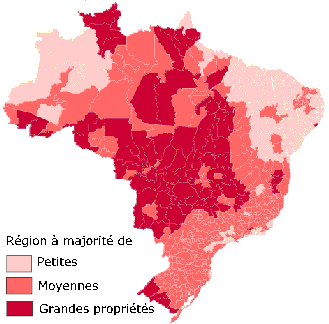Brésil: terres sans paysans
«««RETOUR
La terre est gaspillée dans les grandes exploitations et les ressources agricoles sont sous-employées dans les petites exploitations.
La concentration importante de la terre au Brésil n'a rien favorisé : ni l'emploi agricole ni le développement de la production.
La sous-exploitation de la terre est une des causes majeures de la pauvreté du Brésil.
L'explosion des exportations de soja
Au Brésil, pendant les années 70, les exportations agricoles ont explosé. Le soja, plante inconnue dans le pays vingt ans plus tôt, destinée à alimenter le bétail européen et japonais, est devenue à la fin des années 70 la principale exportation du pays.
Pendant la même période la famine a empiré. Touchant 30% de la population dans les années 60, elle touchait 60% de la population brésilienne dans les années 80.
La surface cultivée en soja s'est accrue de 37% entre 1980 et 1995, atteignant 11.6 millions d'ha. Celà s'est accompagné d'une déforestation massive, chassant les petits paysans de leurs terres. Sur la même période, la production de riz par habitant a diminué de 18%.
75 grandes exploitations représentent 5 fois la surface des petites
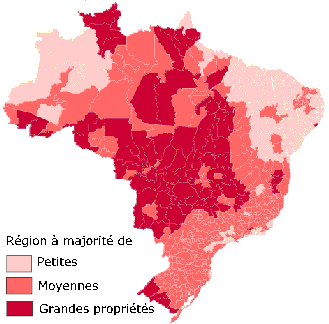 | La concentration de la grande part de la terre agricole du Brésil entre les mains d'une minorité privilégiée s'est produite au cours de décennies d'agriculture d'exportation et de vagues successives de répression contre les travailleurs agricoles et leurs organisations.
Selon les chiffres du ministère de la Politique de la terre, les petites familles d'agriculteurs possédant moins de dix hectares représentent 30.4% des paysans brésiliens mais ne possèdent que 1.5% de la terre agricole. Depuis 1985, le nombre des petites exploitations a diminué de 3 à 1 million.
En revanche, les plus grandes exploitations du Brésil de plus de 1000 hectares ne concernent que 1.6% des paysans mais accaparent 53.2% de la terre agricole.
Les 75 exploitations les plus grandes contrôlent plus de 5 fois la surface totale occupées par les petites exploitations. |
La pauvreté et la faim s'aggravent
La pauvreté et la faim se sont trouvées aggravées par la conversion des terres en pâturages et la forte proportion de terres mises en jachère chez les plus grands exploitants.
Les choix politiques concernant la propriété de la terre ne font qu'accentuer les clivages entre petits et grands exploitants puisque les grands ont très nettement fait le choix de se tourner surtout vers l'élevage et les cultures commerciales et les petits subsistent autour d'une agriculture à vocation principalement vivrière.
Il est connu que l'élevage est une activité peu productive à l'hectare mais elle est productive par actif. À l'inverse la petite agriculture est assez productive à l'hectare mais faiblement productive pour les nombreux actifs qui la réalise. Cette situation engendre bien souvent une sous-exploitation des terres à vocation extensive et une hausse du chômage rural dans les régions à vocation plus intensive.
42.6% de la surface agricole au Brésil n'est pas exploitée, et dans les exploitations de plus de 1000 ha, 88.7% de la terre est laissée à l'abandon.
La terre est gaspillée dans les grandes exploitations et les actifs agricoles sont sous-employés dans les petites exploitations. La concentration importante de la terre au Brésil n'a rien favorisé : ni l'emploi agricole ni le développement de la production.
La sous-exploitation de la terre est une des causes majeures de la pauvreté du Brésil.
Les militaires au pouvoir ont beaucoup favorisé les grands propriétaires terriens dont ils avaient le soutien. A celà il faut ajouter l'échec de la colonisation publique de l'Amazonie dans les années soixante-dix qui permit la constitution d'immenses surfaces agricole ou pastorale.
La transition d'une dictature militaire à une démocratie en 1985 laissait augurer pourtant une réforme agraire d'envergure nationale qui devait profiter à 1.4 million de famille sans terres.
Une réforme avortée dans la violence
Cette réforme gouvernementale rencontra l'opposition des grands propriétaires hostiles à la redistribution: ils ont alors investi 5 millions de dollars pour se procurer des armes et louer les services de vigiles pour empêcher les pauvres de s'installer sur leurs terres.
De 1985 à 1996, on compte plus de 900 assassinats de travailleurs agricoles et de militants du MST, en toute impunité puisque la justice brésilienne n'a prononcé que cinq condamnations.
En 1994, le Ministre de l'économie Cardoso a promis de redistribuer la terre à 280000 familles sur 4 ans, promesse tenue, mais qui n'a profité qu'au cinquième des familles concernées.
Depuis la réforme n'avance guère et les massacres de familles rurales en toute impunité se poursuivent.
«««RETOUR
Source: L'Ecologiste - Peter Rosset (Juin 2002)