
Les côtes Bretonnes sont particulièrement exposées au risque de marées noires. On recense huit grandes catastrophes avec, la plus ancienne - première d'une longue série - le naufrage du Torrey Canyon en 1967, et la plus récente, celle du Ievoli Sun, en 1999.
A chaque fois des dégâts écologiques inestimables avec, à chaque fois, la responsabilité engagée des pétroliers qui continuent de façon scandaleuse à transporter des milliers de tonnes de pétrole sur des navires dont le niveau de sécurité n'est pas à la hauteur.

1967 : TORREY-CANYON
Le 18 mars 1967, le pétrolier libérien Torrey Canyon, armé par une filiale américaine de l’Union Oil Company of California, chargé de 119 000 tonnes de brut, s’échoue entre les îles Sorlingues et la côte britannique.
Malgré une mobilisation de tous les moyens de lutte disponibles, plusieurs nappes de pétrole dérivent en Manche, venant toucher les côtes britanniques et françaises.
Il se révélera plus tard que certains des dispersants utilisés pour la lutte étaient plus toxiques que le pétrole.
1976 : OLYMPIC BRAVERY
Le 24 janvier 1976, le pétrolier libérien Olympic Bravery, naviguant à vide, venant de Brest à destination de Forsund (Norvège) où il doit être désarmé faute d'affrètement, subit une série de pannes de moteur. Le navire dérive vers Ouessant, mouille une ancre mais celle-ci se casse et le pétrolier s'échoue avant l'arrivée du remorqueur qui ne parviendra pas à le déséchouer.
Le 12 mars, l'armateur conclut un accord pour le pompage des soutes et le renflouement du navire, mais le mauvais temps provoque dès le lendemain une détérioration du navire avec une augmentation du nombre d'entrées d'eau.
A la suite d'un fort coup de vent, le 13 mars, l'Olympic Bravery se brise, déversant environ 1200 tonnes de fuel de ses soutes.
Du dispersant est épandu en mer alors que les côtes ouessantines sont polluées sur 4 km.
1976 : BOEHLEN
Le 15 octobre 1976, le pétrolier est-allemand Boehlen, transportant 9500 tonnes de pétrole brut lourd vénézuélien "Boscan" vers Rostock (RDA) est pris dans une violente tempête, et coule au large de l'Ile de Sein.
Le pétrole, réchauffé à 40-45°C pour faciliter le pompage au déchargement, s'échappe en grande partie des citernes. Le plan Polmar est déclenché. De vastes nappes de pétrole affectent le rivage de l'Ile de Sein avant d'atteindre les côtes bretonnes, menaçant la faune (poissons, mollusques et crustacés) locale.
Sur la côte, les militaires récupérent 1 000 t de Boscan mélangé à 7 000 t de résidus divers, à l'aide de seaux et de pelles.
En mer, les responsables Polmar tentent dans un premier temps de colmater les brèches de l'épave (gisant par 107 m de fond) par coulage de béton. Puis, sous la pression des pêcheurs locaux et des professionnels du tourisme, le gouvernement décide en février 1977 de pomper les 2 500 t de brut restant dans les citernes. La méthode, mise au point par l'Institut Français du Pétrole, consiste à entraîner le pétrole par de l'eau de mer chauffée à 80°C. L'opération, menée par le Pétrel, navire français de forage à positionnement dynamique, commence en mai et s'achève fin août 1977. Le brut récupéré en mer est brûlé à l'aide d'une torchère.
25 des 32 membres d'équipage ont perdu la vie dans cet accident, ainsi que 2 plongeurs, durant les opérations de pompage et un soldat chargé du nettoyage du littoral, enlevé par une lame.
1978 : AMOCO CADIZ
Le 16 mars 1978, à la suite d’une avarie de barre et de négociations trop longues avec un remorqueur allemand, après deux tentatives infructueuses de remorquage, le pétrolier libérien Amoco Cadiz s’échoue sur les roches de Portsall, dans le Nord Finistère, chargé de 227000 tonnes de brut.
L’ensemble de la cargaison s’échappe au fur et à mesure que le navire se disloque sur les brisants, polluant 360 km de littoral entre Brest et Saint Brieuc.
C’est la plus grande marée noire par échouement de pétrolier jamais enregistrée dans le monde. Elle conduit le gouvernement à refondre son plan de lutte (le plan POLMAR), acquérir des stocks de matériel (les stocks POLMAR) et imposer des rails de circulation en Manche.
1979 : GINO
Le 28 avril 1979, le pétrolier libérien Gino venant de Port Arthur (Texas) à destination du Havre et transportant 32000 tonnes de noir de carbone (un pétrole raffiné 1,09 fois plus lourd que l'eau) coule au large de l'Ile d'Ouessant, à la suite d'une collision, par épais brouillard, avec le pétrolier norvégien Team Castor.
Environ 1000 tonnes de pétrole, provenant d'un réservoir endommagé, sont déversées par le Team Castor. 17 navires anti-pollution vont épandre du dispersant sur la nappe de fuel.
L'épave du Gino et sa cargaison gisent par 120 m de fond. Le noir de carbone, malgré sa viscosité, se répand aux alentours, mais, sa consistance de "caramel dur" due aux températures relativement froides rend peu probable la pollution des plages bretonnes.
Un sous-marin est envoyé pour surveiller l'épave et prendre des photos. Des campagnes pour surveiller le déplacement du pétrole au fond de l'eau furent conduites par la Marine Nationale pendant de nombreux mois.

1980 : TANIO
La série noire continue.
A l'aube du 7 mars 1980, le pétrolier malgache Tanio, chargé de 26000 tonnes de fuel n° 2, se casse en deux par le milieu, au nord de l'île de Batz (Finistère) par une forte tempête et des creux de 7 mètres.
Malgré l'intervention très rapide des secours, cet accident fait huit victimes et au moins 6000 tonnes de fuel sont répandues à la mer.
Tandis que les opérations de lutte à terre se poursuivent sur plus de 150 Km, un colmatage des fuites de la partie avant de l'épave est entrepris en vue de procéder au pompage de la cargaison selon une technique sensiblement identique à celle utilisée pour le Gino, coulé devant l'île de sein dans le Finistère, avec 14000 tonnes d'hydrocarbures épais (pétrole lourd de BOSCAN) à bord.
1999 : ERIKA
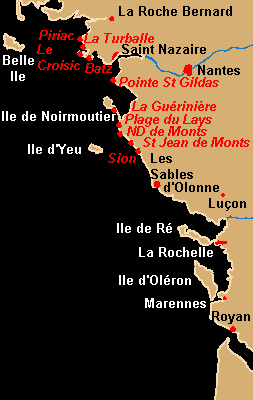
1999 - ERIKA
En rouge, les principaux sites touchés par la marée noire de l'Erika.
2000 : IEVOLI SUN
Le navire, un chimiquier, a sombré en début de matinée, le mardi 30 octobre 2000, à 20 nautiques à l'Ouest-Nord-Ouest de la côte française la plus proche (cap de la Hague).
Il transportait trois sortes de produits chimiques : 4000 tonnes de styrène, 1000 tonnes de méthyl-éthyl-cétone (MEK) et 1000 tonnes d'alcool isopropylique.
Le Styrène est classé B (Substances qui sont bioaccumulées et dont la persistance est de l'ordre d'une semaine ou inférieure à une semaine, ou qui sont susceptibles d'altérer les aliments d'origine marine, ou qui sont modérément toxiques pour la vie aquatique).
C'est un produit considéré comme toxique (toxicité aiguë de 1 à 10 mg/l) et la concentration prévisible sans effet est de 41 micro-gramme/l. En eau de mer, sa toxicité varie entre 2 à 100 mg/l selon les organismes en cause.
Mais c'est heureusement un produit peu bioaccumulable, persistance estimée à environ 1 semaine.
Le méthyl-éthyl-cétone et l'alcool isopropylique sont classés III (Substances qui sont pratiquement non toxiques pour la vie aquatique, ou qui forment des dépôts sur le fond de la mer avec une demande biochimique en oxygène élevée).
Source: CEDRE