Rémy
LESTIENNE :
Temps et Science
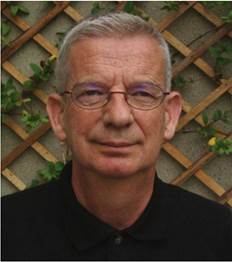
|
Rémy
LESTIENNE : Temps et Science |
Le fil conducteur de mes
réflexions est la notion de Temps et les rapports entre cette notion et
les concepts qui en sont dérivés dans les sciences:
la causalité, l’entropie, le devenir en physique et en biologie,
ainsi que la façon dont notre cerveau utilise cette variable temporelle
pour acquérir et maintenir la connaissance qu’il peut avoir du
monde. Ce fil conducteur m’a amené de la physique, mon domaine de
formation initiale, à la biologie et aux neurosciences. Il m’a
donné l’honneur de présider, de 1998 à 2004,
l’International Society for the Study of Time, forum interdisciplinaire de chercheurs
et penseurs consacré à l’épistémologie du
temps ( www.studyoftime.org )
Chercheur
au CNRS depuis 1962 et Directeur de Recherche depuis 1976, j’ai
d’abord poursuivi des recherches en Physique des Hautes Energies à
l’Ecole Polytechnique de Paris et au CERN à Genève.
Après mon séjour à Alger comme Attaché Scientifique
auprès de l’Ambassade de France, je me suis tourné vers la
biologie et les neurosciences théoriques, domaine dans lequel j’ai
travaillé successivement à l’Université de
Californie du Sud (USC) à Los Angeles (1985-1987), à l’Institut
des Neurosciences de l’Université de Paris VI (1987-1990) puis au
Laboratoire des Neurosciences des Processus Adaptatifs de la même
Université (1994-2005). Entre-temps, j’ai également
assuré des fonctions d’administration de la recherche et de
représentation diplomatique : au Caire (1974-1977), à Alger (1981-1985),
à Washington (1990-1994) et enfin à Brasilia (2001-2005).
Cette
diversité de fonctions m’a amené à m’ouvrir
aussi aux relations internationales et particulièrement aux rapports
Europe-Etats-Unis (j’ai participé activement à la
création de l’Association Euroscience en
1997 – cf. www.euroscience.org), ainsi qu’aux rapports
Europe-Méditerrannée - assurant le secrétariat
du Prix Rammal de 2000 à 2010, et à la
coopération scientifique avec le Brésil, pays de mon premier
séjour à l’étranger et de mon dernier poste
diplomatique.
LIVRES
• Unité et Ambivalence du concept de Temps physique.
Monographie (204 p.). Cahiers d’Histoire et de Philosophie des
Sciences N°9 (Paris, CNRS, 1979).
Essentiel d’un cours délivré au Caire. Aucun
chapitre la physique n’échappe au débat
épistémologique sur le statut des concepts dérivés
de la notion de temps en physique. Les deux approches principales portent
d’une part sur le temps linéaire et homogène de la
mécanique, lié à la causalité, et d’autre
part sur le temps irréversible de la thermodynamique, relié
à l’entropie.
• Les Fils du Temps, Entropie, Causalité, Devenir. 292 p.
Les Presses du CNRS, 1990. Traduit en américain, et
publié sous le titre The Children of Time par University
of Illinois Press, 1995. Nouvelle édition
revue et augmentée, CNRS Editions, 2003, ainsi qu’en format poche
en 2007 et 2016.
A travers le
miroir de l’histoire des sciences, avec Galilée, Newton, Einstein
et d’autres, le livre révèle comment les concepts de
causalité et d’entropie, ces fils qui tissent le temps, ont pu
devenir si contraignants qu’ils ont progressivement été
identifiés à ce dernier.
S’appuyant
sur les acquis récents de l’astronomie, de la physique des
particules mais aussi sur les recherches relatives à
l’ontogenèse des êtres vivants et au fonctionnement du
système nerveux central de l’homme, le livre décrit la
révolution épistémologique actuelle. Le temps n’est
plus le cadre figé d’une scène où la matière
jouerait le premier rôle. Parce qu’il façonne le devenir en
le rendant objectif, le temps apparaît désormais comme facteur
principal de l’histoire, celle du cosmos et celle l’Homme, le plus
« temporel » des animaux.
• Le Hasard Créateur, 282 p., La Découverte, 1993. Traduit en américain, sous
le titre The Creative Power of Chance par
University of Illinois Press,
1998. Traduit en portugais, sous le titre O
Acaso Criador, Editions EDUSP
(Université de São Paulo), 2008.
Ouvrant
l’horizon sur le nouveau et le devenir, la notion de hasard est cousine
de celle du temps. Dans ce livre, l’auteur argumente pour une
réalité objective du hasard et confère au devenir un
statut épistémologique de réalité, selon une
tradition initiée en 1859 en physique par James Clerk
Maxwell et en biologie par Charles Darwin. Depuis les travaux de ces deux
pionniers, bien d’autres découvertes sont venues étayer le
statut d’objectivité concédé au hasard, venues
d’horizons aussi divers que l’exploration du système
immunitaire et celle du système nerveux, l’observation de
l’Univers et l’étude des phénomènes
microscopiques régis par la mécanique quantique.
Ces indices ne nous poussent pas pour autant à abandonner le
programme scientifique : l’idéal scientifique consiste
à repousser toujours plus loin les frontières du hasard, et non
point à affirmer dogmatiquement qu’il n’existe pas.
• Cerveau, Information, Connaissance. (avec Pierre Buser, de l’Institut). 227
p., CNRS Editions, 2001.
Quelles sont
les bases de notre connaissance du monde et comment s’organisent nos
réponses motrices ? On a beaucoup insisté jusqu’ici
sur l’organisation spatiale du cerveau, avec ses réseaux et ses
aires spécialisées. Mais tout aussi essentielle est la gestion
rigoureuse du temps par cet organe de la connaissance. Une gestion du temps qui
se révèle progressivement et s’avère finalement fort
différente de la manière dont travaillent nos ordinateurs usuels.
• Miroirs et Tiroirs de l’Âme. Le cerveau
affectif. Editions du CNRS, septembre 2008.
Le temps est
une réalité complexe et son emprise sur le monde diffère
selon l’objet considéré, de l’atome à
l’Univers et de l’amibe à l’Homme. Le cerveau humain,
par sa complexité, a développé une capacité
particulière à en saisir les diverses facettes et les
différents niveaux. L’émotion, la mémoire, le
traitement de l’information actuelle sont des fonctions distinctes pour
lesquelles le cerveau a développé des réseaux en partie
différents, pour lesquels les centres nerveux de l’amygdale, de
l’hippocampe et du cortex préfrontal jouent des rôles
majeurs. Chez l’Homme, libéré des peurs ancestrales, ces
centres nerveux ont développé, en dialogue avec le système
des neurones miroirs et avec l’aide des réseaux neuromodulateurs,
une aptitude particulière à l’empathie et aux
émotions positives telles que la joie et l’amour. Les
progrès récents de l’imagerie médicale confirment
que le cerveau de l’Homme, construit en grande partie par le dialogue
avec les autres, est particulièrement adapté à la vie sociale,
teintée par l’affectivité.
• Dialogues sur l’Emergence. Editions Le Pommier, mars 2012. Traduit en Américain et
publié comme numéro spécial de Kronoscope, vol. 16, 1, 2016.
Comment expliquer l’apparition de
nouveautés radicales dans la nature, telles que la forme des cristaux,
l’apparition de la vie ou de la conscience ? Un nombre croissant de
scientifiques réhabilitent l’idée déjà
ancienne d’ « émergence »,
selon laquelle, lorsqu’on gravit les échelles de
complexité, de la particule élémentaire aux galaxies et de
l’amibe à l’Homme, des propriétés nouvelles
apparaissent, qu’on ne saurait prédire par raisonnement
réductionniste. « Le tout est plus que l’ensemble
des parties », disent-ils.
Le livre
traverse différents domaines de la science : physique statistique,
chimie, biologie de l’évolution, neurosciences, dans lesquels la
question de l’émergence se pose avec une acuité
particulière. Il le fait sous la forme vivante d’un
dialogue : les trois protagonistes du célèbre livre de
Galilée ‘Dialogue sur les deux grands systèmes du monde’
(Sagredo, Simplicio et ici Salviata plutôt que Salviati), rencontrent dans le
Paris d’aujourd’hui de grands scientifiques disparus tels James Clerk Maxwell, Charles Darwin ou Ilya Prigogine. Leurs
échanges réalistes opposent arguments réductionnistes et émergentistes. En les écoutant, on
découvre les enjeux formidables de cette nouvelle querelle scientifique
et philosophique, qui permet d’éclairer des
phénomènes aussi étonnants que l’envol en formation
des colonies d’étourneaux, le libre arbitre de l’Homme ou la
nature du temps.
• Le Cerveau Cognitif. CNRS
Editions, octobre 2016.
Malgré sa modeste taille, notre cerveau est
d’une redoutable complexité. Aujourd’hui de nouvelles
technologies telles que l’IRM fonctionnelle et de diffusion,
l’optogénétique, les peignes multiples
d’électrodes, permettent l’observation et le contrôle
de réseaux neuronaux avec une précision naguère
inatteignable, et de nouvelles théories générales du
fonctionnement du cerveau voient le jour. Selon ces dernières, le
cerveau est vu aujourd’hui surtout comme une machine complexe à
vérifier la cohérence des informations sensorielles
reçues, à les corriger ou les compléter, et surtout
à en analyser les causes probables. Pourtant, nous ne connaissons
toujours pas précisément la manière dont le système
nerveux central code et transporte l’information fournie par les sens
dans le cerveau et élabore les réponses motrices pertinentes. Ce
que nous avons déjà appris au cours des dernières
décennies n’en est pas moins fascinant, car les travaux des
neuroscientifiques ont permis des progrès considérables,
notamment dans le domaine médical. Avec les médecins et les
psychiatres, les neurosciences se penchent aujourd’hui sur les maladies
du système nerveux central.
• Whitehead, Philosophe du Temps. CNRS Editions, février 2020. Whitehead
Philosopher of Time, World Scientific Publishing, 2022.
La nature du Temps a fasciné bien des philosophes et des
scientifiques, car ce concept paraît recouvrir une réalité
bien plus complexe que la variable continue t qui nous est familière.
Récemment, certains scientifiques ont même proposé
qu’en réalité « le Temps n’existe
pas ». A partir de là, ce mathématicien-philosophe,
trop peu connu en France, a développé une vision de la nature
comme une succession de cristallisations d’objets, ou comme il le dit de
« concrescences d’entités actuelles » dont
chacune apporte avec elle une poussière de temps finie. Sa vision
n’est pas sans rappeler les principes de la mécanique quantique et
de la relativité, et a le mérite de donner un statut
spécial au présent. Par ailleurs, sa philosophie de la Nature, et
la créativité qu’il voit dans son développement,
prévoient une solidarité globale des entités actuelles qui
par certains côtés rappelle la physique quantique, tout en
nécessitant à ses yeux la coopération d’une
entité divine. Sa vision, développée en particulier dans Process and Reality (1929), malgré sa
difficulté et certains échecs qu’il ne faut pas oublier,
reste une source puissante d’inspiration pour la réconciliation
encore à accomplir entre les deux théories rivales de la nature, comme
pour une approche apaisée de la science et de la religion.
• Time
and Science, 3 volumes forwarded by Carlo Rovelli. World
Scientific Publishing, July 2023.
A collective work by 39 eminent
scientists and philosophers of science, who address contemporary debates on the
nature of Time, coordinated by Paul Harris and Rémy Lestienne as
editors. The contributors freely discuss theTime
unity and reality, its compatibility with the orders of classical philosophy
(present, past and future) and with the disputed idea of free will (Volume 1). They
also present a detailed and updated state of the role of Time in the so-called
exact sciences: biology — or more precisely genetics, evolution,
neurosciences, natural and artificial intelligence (Volume 2)
, and physics — relativity, quantum mechanics and quantum gravity,
and cosmology (Volume 3).
Authors list and contents of “Time and
Science”: please use the following QR code

PRINCIPALES PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES
En Neurosciences :
Lestienne R. (2023) Neuroscience reveals the
role of Timing in the Brain. Time and Science, Vol 2, p: 171-206.
Lestienne R. (2001) Spike
timing, synchronization and information processing on the sensory side of
the central nervous system. Prog. Neurobiol. 65:545-591.
Oram M.W., Wiener M.C., Lestienne R. et
Richmond B.J. (1999) The stochastic nature of precisely timed spike patterns in
visual system neuronal responses. J. Neurophys. 81:3021-3033.
Lestienne R. (1999) Intrinsic
& Extrinsic neuronal mechanisms
in temporal coding: a further look at neuronal oscillations. Neural Plasticity, 6:173-189.
Strehler, B.L. et Lestienne, R. (1986) Evidence
on precise time‑coded symbols and memory of patterns in monkey cortical
neuronal spike trains. Proc. Nat. Acad. of Sci.
Lestienne, R. et Strehler, B.L. (1987) Time
structure and stimulus dependence of precisely replicating patterns present in
monkey cortical neuronal spike trains. Brain
Research, 437: 214‑238.
En épistemologie du Temps
:
Lestienne
R. (2018) Whitehead and Roger Sperry. The negation of the instant and the free
will problem. Orpheus’ Glance. Selected
papers on process psychology.
Louvain-la-neuve : les Editions chromatika, p. 145-162.
Lestienne
R. (2000) Chance, progress and complexity in biological evolution. SubStance, vol 29, 1,
p. 39-55.
Lestienne R. (1997) Le Hasard et le Temps. Agone, 17: 13-23.
Lestienne, R. (1988) From
Physical to Biological Time. Mech. Ageing & Develop., 43 : 189‑228.
Lestienne, R. (1987) A la mémoire de Ludvig Boltzmann :
l'Entropie est‑elle objective ? Fundamenta Scientiae, 8 :173‑184.
En physique des Hautes Energies
:
Lestienne R. (1967) Etude d’interactions à haute
multiplicité : les collisions à six branches chargées
de π+ de 5 Gev/c sur l’hydrogène.
Thèse de Doctorat d’Etat ès Sciences Physiques,
Université de Paris.
Drevermann, H., Idschok, U., Winter, G., Böckmann,
K., Apostolakis, A. J., Briggs, G., Kitchen, C. A., Major, J. V., Pols,
C. L., Schotanus, J., Toet,
D., van de Walle, R. T., Lestienne, R., Fleury, P.,
& Grosso, C., Quassiati, B., Rinaudo,
G. and Werbrouck, A. (1967). Study of the
6-Pronged π+p Interactions at 5 GeV/c. Physical Review 161: 1356-1374.
Lestienne R., Chaurand B., Drévillon B.,
Gago J.M., Labrosse G., Salmeron
R.A., Barrier M., Brandao
M.A. et Ngyuen H.K. (1973). Pt distributions in hadronic interactions with and without baryon exchange
around 5 GeV/c CMS energy, Nucl. Phys. B, 67 :348-361.
Sur la coopération
scientifique entre la France et le Brésil :
Lestienne R. (2006) Brésil : perspectives scientifiques et
technologiques. Futuribles, No 322,
59-70.
Lestienne R. (2006) Brésil : Un pays scientifique
émergent. Géopolitique, No
96, 49-58.
Lestienne R. (2006). Quatro anos
de cooperação universitária e cientifica entre a
França e o Brasil, in “Diálogos
entre o Brasil e a França” (organizador: Carlos Benedito Martins),
Editora Massagana, p: 259-270.
Contact : lestienner@gmail.com